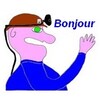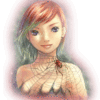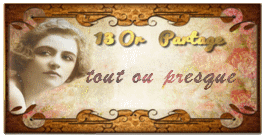-
Par Rose de Picardie 1 le 24 Août 2019 à 00:13

Pourquoi souhaite-t-on bonne chance en disant “Merde” ?
L’interjection « merde » est d’abord un juron. Connue comme « le mot de Cambronne », elle fait référence à un passage très précis du roman de Victor Hugo, Les Misérables. L’auteur y relate un évènement survenu lors de la bataille de Waterloo. Le général Pierre Cambronne aurait ainsi eu recours au mot « merde » lorsque le général britannique Charles Colville lui intima l’ordre de rendre les armes.
Quant à sa signification relative à la chance, il n’y a aucune certitude quant à son origine. Cependant il est communément admis qu’elle vit le jour dans le monde du théâtre à la fin du 19ème siècle. En effet utiliser les termes « bonne chance » était alors censé porter malheur. Il fallut trouver une astuce et on eut recours à une expression de substitution.
A cette époque on pouvait juger du succès d’une pièce par le nombre de fiacres et donc d’attelages de chevaux attendant les spectateurs à la sortie du lieu de spectacle. Aussi le nombre de crottins était proportionnel au succès d’une pièce. Souhaiter de la merde signifiait par conséquent souhaiter plein succès à une pièce.
A noter que l’acteur à qui un « merde » est adressé ne doit pas, selon la tradition, exprimer de remerciements en retour.
Du monde du théâtre l’usage de l’expression s’est ensuite progressivement répandu dans la société. 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Rose de Picardie 1 le 16 Octobre 2018 à 10:26

D’où vient l’expression « se mettre martel en tête » ?« Se mettre martel en tête » signifie s’inquiéter d’une situation ou au sujet d’une personne. A première vue il s’agirait d’une référence directe à Charles Martel, grand père de Charlemagne. Mais il n’en est rien. Ce « martel » est un ancien outil, une sorte de marteau.A l’origine, c’est à dire au 16ème siècle, « avoir martel » signifiait « être perturbé par un sentiment de jalousie ». Mais rapidement l’expression prit le sens de « se faire du souci ».La métaphore est claire et très parlante. Elle compare les tourments, les interrogations répétées et le questionnement ininterrompu, à des coups de marteaux dans la tête.Au 18e siècle le sens de l’expression se fixa et désigna l’obsession de préoccupations diverses.Le verbe « marteler » en découle. On peut ainsi lire sous la plume de Voltaire : « Je viens pour soulager le mal qui me martèle. » 3 commentaires
3 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique